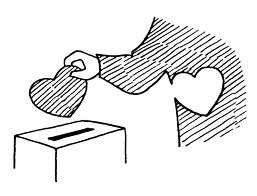Chers Frères et Soeurs,
Quel peut bien être le point commun entre ces trois textes que j’ai choisis pour nous ce matin ? Dans le premier, extrait du livre de la Genèse, le verbe central est celui de « je vous donne » ; dans le deuxième, la demande d’Elie à la veuve de Sarepta est : « Va me chercher » un peu d’eau, puis « fais-moi d’abord une petites galette » ; dans le troisième, extrait de l’évangile de Marc, cette réflexion de Jésus sur ces petites pièces mises par une veuve pauvre dans le tronc du Temple de Jérusalem, le verbe central est celui de « mettre » : de nombreux riches « mettent » beaucoup ; la veuve pauvre « mit » deux petites pièces ; « tous ont mis en prenant sur leur superflu » ; « mettre tout ce qu’elle possédait ». Donc, du point de vue sémantique, pas de lien. Mais, au-delà, le même axe : celui du don.
Don premier de Dieu, nous y reviendrons ; don de la veuve de Sarepta à Elie, à Elie en premier, le reste de ce qu’il y aura pour se nourrir étant alors pour cette veuve et son fils ; don de cette autre veuve, pauvre, au Temple de Jérusalem.
Don, abandon ; c’est de don qu’il s’agit.
Vous pourriez vous dire : c’est parce que nous approchons de Noël qu’il a choisi d’axer sa réflexion sur le don ; ou bien encore : il est vrai que nous approchons de la fin de l’année et qu’il est en train de nous rappeler que notre église compte sur nos dons !
Eh bien, non, ce n’est pas cela. C’est la résultante d’un certain nombre de faits, de réflexions, depuis pas mal de temps.
Et très concrètement, une toute petite anecdote, récente, que je partage avec vous, en pensant bien que chacun d’entre nous a été dans cette situation. Dimanche dernier, au moment de l’offrande, je réalise que je n’ai sur moi, en argent, que quelques centimes qui traînent au fond d’une poche, pas de carnet de chèque, et un portefeuille dans lequel il y a un billet de banque ; billet que je destine à des courses, billet d’une valeur en argent certaine. Dans ces moments-là, il faut agir rapidement : la quête s’approche, ce n’est pas le temps de tergiverser. Evidemment, on peut détourner le regard, faire comprendre qu’on n’a rien sur soi, faire semblant en quelque sorte. Mais on ne le fait pas : alors, mettre ces quelques centimes ? Mettre ce billet ? Les deux sont possibles et les deux ont été faits, peuvent être faits. Il ne s’agit ici ni de juger, ni de dire ce qu’il faut faire. Mais peut-être alors se dit-on : mais, en fait, pour quelle finalité, pour quelle raison fais-je réponse à cette demande ? Pour quoi, au nom de quoi ? Et alors peut apparaître une autre dimension, une prise de conscience. Prise de conscience de ce que signifie un don, ici un don d’argent.
Mais il y a d’autres mode de dons.
La question se pose alors de se demander ce qu’est le don, ce que recouvre le don, ce qui signifie le don. Le don est-il un acte de générosité ? Le don est-il unilatéral, de la part de celui qui donne ? Le don est-il un acte gratuit ? Est-ce que le fait de professer notre foi chrétienne nous donne un regard particulier sur le don, sur le fait de donner ?
C’est ce que nous allons essayer de comprendre, de partager. Dans ce que je vois pour ce qui est de la relation humaine, sociale, j’allais dire d’homme à homme, d’abord ; puis dans ce que je comprends de notre relation à Dieu.
I. Dans une relation strictement humaine :
Même s’il ne nous semble a priori pas vraiment consubstantiel à notre être, à notre « agir » – qui fait que, premièrement nous sommes probablement plus enclins à prendre et à garder, sans partage, et même probablement en pensant à nous d’abord – il semble bien que le don, la pratique du don soit ancienne.
Elle l’est alors dans un registre de vie sociale, de relation sociale. Et les motivations sont complexes, d’une culture à l’autre, d’une période de temps à une autre, d’un conditionnement de notre être à un contexte particulier.
Je prends quelques exemples, parmi des milliers.
Quand, sous l’Ancien Régime, le don se pratique, il s’agit, du moins chez les puissants du temps, d’une pratique codifiée : il est entendu par exemple qu’au moment de sa mort, le maître doit non seulement avoir pris ses dispositions pour que sa domus, ceux qui l’ont servi, soient payés de tous leurs gages ; mais encore, il est attendu de lui qu’il fasse des dons, et des dons proportionnés à son rang et à sa fortune. Il y va du respect par lui d’une pratique, d’un ordre établi, su de tous, qui fait que celui qui a été servi, que celui qui dispose de la richesse matérielle, en donne à ses proches, mais aussi ses obligés, ses serviteurs. Dans une société de classes, de castes, de rang, dans une société pyramidale où la relation se conçoit de seigneur à vassal, il appartient à celui qui a eu une puissance, matérielle, politique, de se montrer à la hauteur de cette puissance et d’en témoigner auprès d’autrui.
On est bien là dans un don, mais un don attendu, un don codifié. Un don qui est fait en contrepartie de quelque chose. Un don qui oblige autant le donateur – qui ne peut passer outre – que le donataire, qui, en acceptant ce don, se met ou se conforte dans une position d’obligé, de débiteur en quelque sorte.
Autre exemple, que l’on m’avait donné lorsque j’étais en activité professionnelle, parmi les usages qu’il fallait connaître pour mieux appréhender la relation avec certains pays d’Orient : celui du don et du contre-don. Il n’aurait pas été pensable d’entamer une négociation sans l’offrande de présents, de dons. Cela faisait là encore partie de la règle bien comprise, du mode d’entrée en relation, d’une forme de courtoisie.
Encore un exemple. L’usage bien ancré semble t’il chez nos frères et sœurs au Japon, de faire des dons lorsque l’on a voyagé, de rapporter des présents, pour marquer son amitié, pour s’excuser d’avoir été absent, etc.
Un dernier exemple, que je vis en ce moment, où je suis en détachement pour toute l’année 2021 auprès de l’un de nos musées parisiens, en attendant l’arrivée de ma retraite officielle cette fin décembre. Alors que j’ai la charge de l’étude de l’une des collections de ce musée, je constate combien celle-ci s’est enrichie au fil des années par des dons. Là encore, d’autres motivations : désir sincère d’enrichir une collection d’Etat, désir de reconnaissance par ce musée, peut-être aussi parfois affirmation d’une aisance financière, volonté de voir des œuvres aimées atterrir en un lieu hors du marché, avec une conservation pérenne ; souhait de faire profiter le visiteur d’un objet jusqu’alors gardé dans le secret d’une collection privée ; souhait, par ce don, d’honorer la mémoire d’une personne disparue… Les motivations sont multiples. Elles sont, là encore, créatrices d’un lien social, ou en reconnaissance d’un état social. On donne, parce que l’on a eu, parce que l’on a eu la possibilité de détenir ; on donne par reconnaissance, par une forme d’altruisme.
En point commun, je dirais ici que, si ces dons ne sont certes pas à négliger, s’ils sont même de mon point de vue à encourager, s’ils ont en commun une certaine dose d’altruisme, de dépossession, de création ou d’affirmation d’un lien social – tout ceci étant loin d’être négligeable -, ils s’inscrivent quand même tous dans une relation d’obligeant à obligé.
Je veux dire par là qu’aucun de ces dons, quand bien même encore une fois la finalité peut être intéressante, ne revêt, à mes yeux, de dimension de gratuité. Je ne vois pas ici quelque chose d’entièrement gratuit ; j’en retiens cependant, quand même, un début de décentrement de soi, un état où celui qui donne considère la personne de celui qui reçoit ; une forme de dépossession, aussi. Ce qui est donné n’est plus au donateur.
Pour ce qui suit, je vous avoue que j’ai bien pesé le pour et le contre avant que de choisir de l’évoquer devant vous ce matin. Mais j’ai choisi de le faire, aussi parce que ces faits, depuis que j’en ai eu la connaissance, c’est-à-dire lors de mon adolescence, quand je commençais à lire des livres sur notre Histoire, ces faits m’ont marqué et me marqueront toujours.
En juillet 1941, dans le camp d’Auschwitz où est interné le père franciscain Kolbe, un prisonnier parvient à s’échapper. En représailles, le nazi qui dirige ce camp ordonne que dix des 599 prisonniers du bloc soient condamnés à mourir de faim et de soif au bloc. Le règlement du camp exigeait, pour décourager les évasions, que dix détenus soient exécutés en cas d’évasion d’un homme. Dix hommes sont alors sélectionnés, dont un père de famille. Maximilien Kolbe entend cet homme s’écrier : Ma pauvre femme ! Mes pauvres enfants ! Que vont-ils devenir ? ». Il propose alors de mourir à sa place. Selon ce qui a été rapporté, alors qu’on lui demandait de décliner son identité, ses paroles auraient été : « Je suis un prêtre catholique de Pologne ; je voudrais prendre sa place, car il a une femme et des enfants ». Kolbe fut alors détenu dans un block sans eau ni nourriture. Il mourut quelques semaines plus tard, alors qu’il avait survécu à ce régime, d’une injection létale.
Ces faits ne peuvent recevoir aucuns commentaires. Les seuls constats que je prends la liberté de faire maintenant sont ceux-ci :
C’est en sa qualité de chrétien que Kolbe se présente à l’autorité nazie. C’est donc, de mon appréciation, au vu d’une cohérence entre ce qu’il croit fermement, ce qu’il est, qu’il offre sa vie. Qu’il s’offre. Il n’y a là aucune contrepartie possible, il n’y a aucun retour. Que Maximilien Kolbe ait été par la suite béatifié puis canonisé comme martyr ne change rien, n’apporte rien, de mon point de vue. Ceci m’est, pour le coup, étranger. Mais ce jour-là, un homme s’est dressé contre ce qu’il considérait – et qui est – une abjection ; il a donné sa vie pour celle d’un autre, en pesant la sienne à l’aune de celle de l’autre et par cohérence envers ce qu’il était, au fond de lui-même, en cohérence totale avec la foi qui était la sienne.
Au regard de ce qui précède, que pouvons-nous tirer, pour nous ici et maintenant, des textes que j’ai choisis pour ce jour ?
II. Dans ce que peut être notre relation à Dieu :
De ces trois textes, j’ai choisi de tirer deux enseignements.
- Le premier, illustré par cet extrait du livre de la Genèse, qui est le premier qui me soit venu à l’esprit, mais beaucoup d’autres auraient tout aussi bien pu être retenus :
C’est que le seul auteur du don, celui qui en a la primauté absolue, est Dieu. Dieu et Dieu seul, et ce de manière universelle et gratuite ; alors qu’à la suite de Marcel Mauss, considéré comme « le père de l’anthropologie française », qui exposa sa pensée dans son Essai sur le don paru en 1923-1924, je reste plus que dubitatif sur la possibilité du don gratuit, de la part de l’Homme. Le don, la grâce, sont premiers ; nous ne sommes que, nous ne pouvons être que des récipiendaires.
Par là même, nous donnons moins ce qui nous appartient que ce que nous avons reçu.
Ceci ne signifie nullement que nous devions rester passifs, bien au contraire. Il nous appartient :
- D’abord, de prendre conscience de ce que nous ne sommes que des récipiendaires ; et d’en rendre grâce ;
- Ensuite, de tenter de prendre la mesure de l’immensité du don fait ;
- D’en prendre soin et de le partager, de ne pas garder pour nous le don reçu ;
- Dans la mesure de ce que chacun de nous peut faire, et chacun de nous peut faire quelque chose, de faire fructifier ce don, de le démultiplier.
2. Le deuxième enseignement me semble pouvoir être le suivant :
Dans les deux récits entendus, sont présentées deux femmes, deux veuves, deux personnes qui sont dans le dénuement matériel le plus total. Dans les deux récits, ces deux personnes se rejoignent par le don.
Mais, notez-le, dans le récit de Marc, Jésus observe et constate des faits. Contrairement à beaucoup de ce que j’ai lu, y compris comme prédications sur ces versets, en aucun cas il ne s’agit ici pour Jésus de donner cette veuve en exemple.
Il s’agit plus ici de dénoncer une fois de plus un système pervers, celui d’un Temple lieu de richesse, lieu de pouvoir. Dénonciation par Christ d’une piété réglementée, dénonciation de ceux qui, avant tout veulent être vus, et veulent que ce qu’ils font se sache. La ruine du Temple suivra quelques versets plus loin.
En, revanche, me semble-t-il, et vous avez noté que Jésus fait précéder son adresse aux disciples de ces mots : « En vérité, je vous le déclare… » indique clairement qu’il s’agit ici non d’un enseignement moral que d’une vérité », ce que Jésus constate c’est qu’ici, par cet acte, cette pauvre veuve ne compte pas, qu’elle ne mesure pas. En ne comptant pas, en ne proportionnant pas son don à sa ressource, cette veuve rompt totalement avec une logique comptable préétablie. En quelque sorte, elle affirme une liberté, une indépendance par rapport à un système. Elle en propose, à sa manière, un autre.
Pour ce passage des Rois, l’approche me semble un peu différente. Certes, la veuve de Sarepta est dans ce même dénuement total, ce qu’elle exprime d’ailleurs auprès d’Elie. Mais il ne s’agit pas ici de rentrer ou non dans un système religieux quel qu’il soit. Il s’agit d’abord – et de nouveau sans compter, sans proportionner le geste que le prophète lui demande d’accomplir – de rompre là encore avec une forme d’économie domestique privée. De faire d’abord confiance à ce que dit Elie.
Alors, finalement, de voir dans le don l’expression, une des expressions de la foi.
De se dire, une fois de plus, que d’abord et avant tout, nous sommes au bénéfice du don qui nous a été fait ; et ensuite, parce que nous sommes au bénéfice de ce don et en aucun cas pour répondre, pour être à la hauteur de ce don, de se remettre entièrement à Dieu.
Pouvons-nous faire autrement ?
C’est ce que je ne crois pas.
Amen.